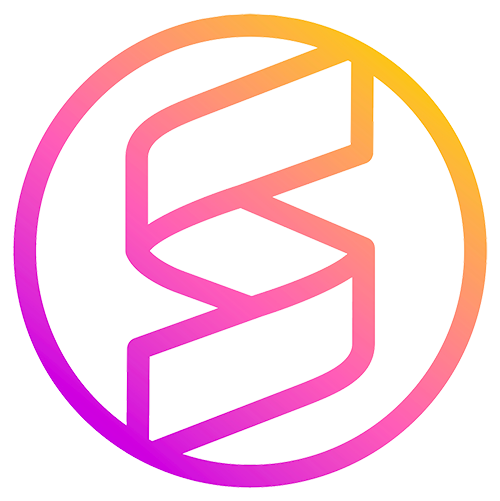Les grandes sociétés d’investissement sont toujours prudentes lorsque, en décembre, elles égrènent leurs prévisions pour l’année à venir. Cette fois-ci, ils sont encore plus prudents que d’habitude et extraordinairement concis : en effet, si l’on fait abstraction des deux estimations les plus extrêmes, les objectifs de prix imaginés pour l’indice S&P500 à la fin de 2023 sont tous très similaires. Les 17 analyses prises en considération donnent une moyenne d’un peu plus de 4 000 points, par coïncidence le même niveau touché par l’indice il y a quelques jours. À Wall Street, on semble avoir compris que l’année prochaine, la croissance sera nulle ou presque nulle. Cependant, cette grande homogénéité cache une profonde incertitude et un espoir généralisé.
En effet, alors que personne ne se sent capable de prédire comment l’économie se comportera, combien de temps durera le resserrement monétaire de la Fed, comment les bénéfices des entreprises se comporteront, et donc comment le marché boursier se comportera, les principaux stratèges semblent s’être mis d’accord sur l’hypothèse qu’il y aura une récession, mais qu’elle sera légère et douce, presque indolore, bien qu’il y ait eu très peu de récessions légères dans le passé. En l’annonçant presque unanimement comme quelque chose de jamais vu auparavant, au point que plusieurs économistes de banques d’investissement ne se sont même pas rendu compte de sa présence alors qu’elle faisait déjà rage, on tente de l’exorciser et le résultat est que « cette fois, ce sera différent » : deux trimestres de PIB à peine négatif, suivis d’une reprise robuste imaginée qui clôturera l’année avec une économie qui croîtra de 0,4 %, comme le montre la moyenne des prévisions des 9 grandes banques internationales.
Un parcours mouvementé
Il s’ensuit que Wall Street connaîtra également un parcours mouvementé : chute au premier semestre, l’indice pouvant descendre jusqu’à 3 000-3 300 points, puis forte reprise, jusqu’à plus de 4 000 points, voire les 4 500 hypothèses de la Deutsche Bank. Selon les recommandations de Bank of America, l’accent devrait être mis sur les obligations et les titres d’État au cours des prochains mois, puis sur les actions au début de l’été. Même l’optimiste Goldman Sachs semble maintenant concéder que, à Wall Street, nous pourrions revisiter les plus bas de début octobre (3 577).
Les prévisions pour la zone euro suivent celles de l’Amérique, à la différence qu’ici la récession serait déjà en cours, 4 à 5 mois plus tôt qu’aux États-Unis. Mais, malgré un coût de l’énergie environ 5 fois plus élevé qu’aux Etats-Unis, la récession sera également douce, ou plutôt très douce : pour la zone euro, elle se traduirait par une croissance nulle en 2023 (-0,1% selon Goldman Sachs et zéro pour Bofa) et ne toucherait presque que l’Allemagne (PIB -0,4%) et l’Italie (-0,2%).
Bien sûr, les prévisions officielles, celles de la banque centrale, de l’UE, des agences de notation ou des différents gouvernements, sont bien meilleures. Mais, il faut noter que les estimations des banques d’investissement deviennent également moins pessimistes comme le rappelle Netpublic dans son comparatif et cela se reflète dans la performance des bourses européennes au cours des deux dernières semaines, qui est plus prometteuse que celle de Wall Street. Tout comme le S&P500, l’indice Stoxx tomberait à 408 à la mi-année (en baisse de 7 % par rapport à la clôture de mercredi) et finirait à 434 en décembre, selon un sondage Reuters réalisé il y a quinze jours. Mais, dans l’enquête la plus récente de Bloomberg, il passerait à 449 points avec une appréciation modeste (2,7 %) à partir d’aujourd’hui. C’est étrange à dire, mais pour les marchés européens, le creux de la fin septembre (383 points) ne serait plus qu’un souvenir.
L’histoire
La valeur de ces prévisions, l’histoire nous le dit. L’enquête précise de la Fed de Philadelphie place la probabilité d’une récession à 63%, un record absolu. Mais si aujourd’hui, presque tous les économistes et investisseurs interrogés disent s’y attendre, il est difficile de comprendre pourquoi presque personne ne l’a prédit en 1990, 2001 et 2008, lorsque moins de 22 % des personnes interrogées l’estimaient probable.
La fiabilité des estimations des différents stratèges sur l’évolution du marché est encore pire. En décembre 2019, ils ont sous-estimé l’objectif de l’indice S&P de 15 % ; en 2020, ils l’ont manqué de 18 % et en 2021, ils l’ont surestimé de 22 %. Ils ont imaginé le taux de la Fed à 0,87% : 3,5 points de pourcentage de moins que ce qui sera fixé après-demain. La seule indication que l’on peut tirer de ces prévisions est l’humeur du moment, et ce que l’on ressent actuellement est une confiance modérée dans le fait que les choses s’amélioreront dans six ou sept mois.
Ce n’est pas un hasard si, cette année, plusieurs banques se sont livrées à la peinture de trois scénarios : un considéré comme basique, auquel elles attribuent des probabilités d’environ 50%, un pessimiste et un autre optimiste. Goldman Sachs, Ubs, Morgan Stanley, T Rowe et BofA ont été particulièrement actifs dans cet exercice. Prenons par exemple l’analyse de cette dernière, la maison même qui, avec Morgan Stanley, avait partiellement prédit les performances de Wall Street en 2022. L’indice S&P, selon Savita Subramanian, responsable des actions américaines, devrait finir dans 12 mois à 4 000 si tout se passe comme prévu. Mais si tout va mal, il s’effondrerait à 3 000 et si les choses vont mieux que prévu, il s’envolerait à 4 600. Un bon 53% passe entre l’objectif minimum et maximum, et avec cet artifice BofA couvre tout le spectre des possibilités.
Ce sont souvent les détails des analyses qui laissent un peu perplexe. En estimant l’évolution des bénéfices des entreprises, une demi-douzaine de banques, dont BofA et Goldman, illustrent comment, lors des récessions précédentes, les bénéfices ont chuté en moyenne de 20 à 30 %. Mais cette fois, tout en peignant le pire scénario, ils supposent une baisse de seulement 9-10%, la justifiant par une série d’arguments dont le dénominateur commun est que « cette fois-ci est différente ». Le même refrain que les stratèges et les économistes avaient répété tant de fois en 2008, avant la grande crise.